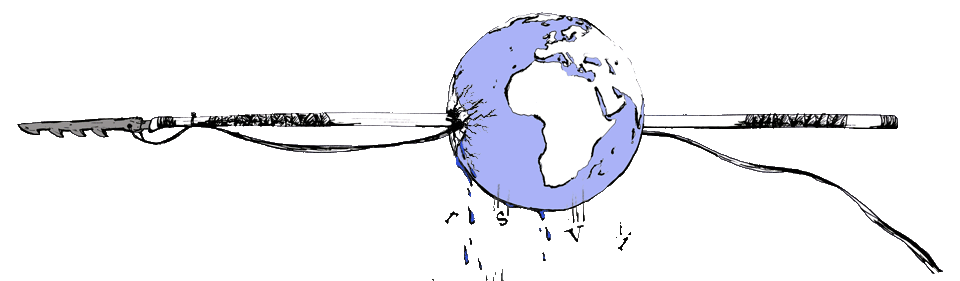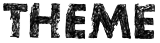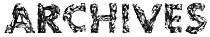La Littérature sud-africaine au 20ème siècle : fille de l’apartheid aux multiples voix
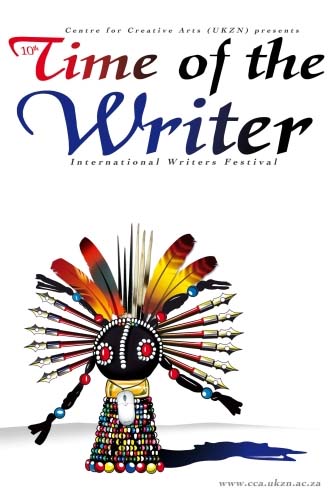 « Jamais le lien qui unit un contexte historique à des productions littéraires n’a été sans doute aussi fort«
« Jamais le lien qui unit un contexte historique à des productions littéraires n’a été sans doute aussi fort«
« L’écrivain est celui qui invite ses lecteurs à ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure, et à protester »
« L’histoire des littératures de ce pays, c’est celle de voix qui se cherchent, qui s’entrecroisent, mais qui ont les plus grandes difficultés à se rencontrer et à communiquer »
Pour étudier la place de la littérature dans l’Afrique du Sud soumise aux lois de l’apartheid, je ferais référence à un auteur qui a fait en ce sens un travail remarquable. Jean Sévry enseigne les littératures et les civilisations africaines à l’Université de Montpellier. Les citations précédentes sont issues de son ouvrage Afrique du Sud, Ségrégation et Littérature, Anthologie critique, paru chez l’Harmattan en 1989. Jean Sévry y propose une analyse profonde et émouvante des littératures sud-africaines dans toute leur diversité. La présentation suivante se veut une brève synthèse de sa recherche, mais je ne peux qu’inviter les plus curieux à lire le livre dans sa globalité : la succession des textes choisis par l’auteur (extraits de romans, de nouvelles, d’essais, d’écrits législatifs) permet d’entrer au cœur de l’intime des auteurs sud-africains (Blancs, Noirs, Bantous, Métis, Indiens), et de nous imprégner d’un contexte lointain, difficilement accessible par le biais d’un autre vecteur.
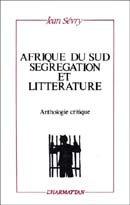 Aborder la question de la littérature en Afrique du Sud, c’est aborder une production nourrie de la pluralité originelle de ses auteurs. C’est entamer un voyage entre poésie, roman et essais critiques. C’est entrer dans la ronde de multiples jeux de l’énonciation littéraire, au travers d’observations critiques et douloureuses d’auteurs, hommes et femmes, issus d’une même réalité sans jamais l’être totalement. Suivant la ligne directrice de Jean Sévry, nous catégoriserons dans un premier temps les différentes voix s’élevant dans la littérature sud-africaine, pour nous plonger ensuite au cœur des propos même de ces auteurs, visualisant ainsi l’ensemble des thèmes récurrents évoqués, et leur signification fortement intentionnelle.
Aborder la question de la littérature en Afrique du Sud, c’est aborder une production nourrie de la pluralité originelle de ses auteurs. C’est entamer un voyage entre poésie, roman et essais critiques. C’est entrer dans la ronde de multiples jeux de l’énonciation littéraire, au travers d’observations critiques et douloureuses d’auteurs, hommes et femmes, issus d’une même réalité sans jamais l’être totalement. Suivant la ligne directrice de Jean Sévry, nous catégoriserons dans un premier temps les différentes voix s’élevant dans la littérature sud-africaine, pour nous plonger ensuite au cœur des propos même de ces auteurs, visualisant ainsi l’ensemble des thèmes récurrents évoqués, et leur signification fortement intentionnelle.
1. Les voix d’Afrique du Sud : reflet de douleurs, de doutes et de trajectoires multiples.
-
Les voix noires :
Je vous propose de commencer notre exploration des écritures sud-africaines au travers des spécificités de la littérature noire.
Celle-ci s’est longuement caractérisée par son oralité, dans une forme propre à l’ensemble du continent et adaptée à la forme souvent nomade des peuplades traditionnelles. Dans l’Afrique du Sud du 20ème siècle, ce style millénaire de la littérature orale a connu une sorte de résurgence au travers de nouvelles formes littéraires, inspirées du passé et remaniées dans un format propre à s’ancrer dans le présent. L’épopée guerrière et le chant de louange ont ainsi connu une période de regain sous la plume de certains auteurs, tels que Mazisi Kunene et Thomas Mofolo.
 Néanmoins, la littérature noire moderne se veut davantage le fruit de la révolution industrielle de la fin du 19ème siècle. Marqués par les mouvements de populations des zones rurales aux zones urbaines, et par les violences et la misère des vies de forçats dans les mines, les écrivains noirs se sont faits les témoins des souffrances de leur peuple, et ont ainsi inventé une nouvelle forme littéraire proche du journalisme et du roman réaliste. Si Benedict Wallet Vilakasi, poète zoulou, fut le précurseur de cette littérature, en témoignant dans ses oeuvres de la servitude des mères et de l’exploitation des travailleurs noirs, d’autres auteurs ont pris le relai de sa plume réaliste, tout en lui donnant davantage encore de verve et d’intentions provocatrices (Bloke Modisane, Lewis Nkosi ou encore Casey Motsisi, pour n’en citer que quelques uns).
Néanmoins, la littérature noire moderne se veut davantage le fruit de la révolution industrielle de la fin du 19ème siècle. Marqués par les mouvements de populations des zones rurales aux zones urbaines, et par les violences et la misère des vies de forçats dans les mines, les écrivains noirs se sont faits les témoins des souffrances de leur peuple, et ont ainsi inventé une nouvelle forme littéraire proche du journalisme et du roman réaliste. Si Benedict Wallet Vilakasi, poète zoulou, fut le précurseur de cette littérature, en témoignant dans ses oeuvres de la servitude des mères et de l’exploitation des travailleurs noirs, d’autres auteurs ont pris le relai de sa plume réaliste, tout en lui donnant davantage encore de verve et d’intentions provocatrices (Bloke Modisane, Lewis Nkosi ou encore Casey Motsisi, pour n’en citer que quelques uns).
L’émergence du « Black Counsciousness » (Mouvement pour la Conscience noire) dans les années 1960 modifia une fois encore la tendance de la littérature noire : mouvement construit par la volonté de se revendiquer en tant que peuple noir dans une société plurielle, il marque avant tout la fin des illusions de tout une communauté. C’est ainsi que les intellectuels, les artistes et les écrivains noirs se sont recentrés autour de thèmes clairement identifiés, propres à la culture noire dans la situation sud-africaine, et adressés à cette même population. Les poètes Mtshali, Serote et Don Mattera ont ainsi construit une littérature en direction exclusive de la Communauté noire, et ont affiché leur solidarité sans faille à sa lutte.
A un autre pôle, la détresse de ces auteurs, victimes et témoins de la ségrégation, s’est traduite par un mouvement de doutes et de remises en cause de la littérature. Sa fonction et son utilité, dans un contexte désespéré, ont été questionnées, donnant naissance à un ensemble d’ouvrages aux titres évocateurs : A bas la littérature, de Mutloatse ; L’Apartheid, c’est poétique ?, de Pascal Gwala ; Faire un poème ?, de James Matthews… Cette tendance, bien que compréhensible dans le contexte d’apartheid, et souvent observée dans les pays traversant une crise sociale majeure, n’a pas empêché un certains nombres d’autres auteurs, dans une démarche opposée, de projeter et de porter dans leurs oeuvres la voix des opprimés. Ces artistes ont ainsi tenté de lutter, grâce à la force évocatrice de l’écriture, contre l’impuissance et le découragement du peuple (Muriel Tlali et N.S. Ndebele, entre autres).
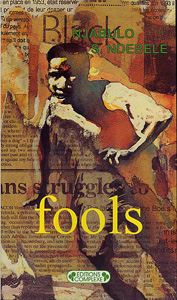 Ainsi, au cours du 20ème siècle, la littérature noire fut clairement marquée par les soumissions et les humiliations subies par son peuple. Il en ressort une tendance globale au rejet de l’esthétisme en faveur d’un réalisme forcené, bien plus à même, au coeur de la crise, de transmettre l’image de la tyrannie Apartheid et des sentiments d’abandon de la communauté. Ce réalisme fut parfois relayé par la voix d’écrivains blancs, dans ce que Jean Sevry appelle une « littérature de magnétophone », c’est-à-dire un ensemble d’ouvrages à l’intérieur desquels l’auteur blanc s’efface pour donner la parole exclusive au témoin noir (exemple de Poppie, de Elsa Joubert, dans lequel on assiste au récit d’une nounou africaine qui nous conte sa vie).
Ainsi, au cours du 20ème siècle, la littérature noire fut clairement marquée par les soumissions et les humiliations subies par son peuple. Il en ressort une tendance globale au rejet de l’esthétisme en faveur d’un réalisme forcené, bien plus à même, au coeur de la crise, de transmettre l’image de la tyrannie Apartheid et des sentiments d’abandon de la communauté. Ce réalisme fut parfois relayé par la voix d’écrivains blancs, dans ce que Jean Sevry appelle une « littérature de magnétophone », c’est-à-dire un ensemble d’ouvrages à l’intérieur desquels l’auteur blanc s’efface pour donner la parole exclusive au témoin noir (exemple de Poppie, de Elsa Joubert, dans lequel on assiste au récit d’une nounou africaine qui nous conte sa vie).
-
Les voix blanches : Afrikaners et Anglophones.
L’Afrique du Sud de l’apartheid est construite autour de la domination sans concession de la race blanche sur l’ensemble des autres races en présence. Néanmoins, par son histoire et ses colonisations successives, l’Afrique du Sud est porteuse d’une identité blanche double, dont les visages, Afrikaner et Anglophone, ne portent ni les mêmes stigmates ni les mêmes ambitions.
C’est ainsi que la littérature de ces deux peuples n’est ni soeur, ni voisine, mais qu’elle est bien le reflet des préoccupations et des questionnements profondément différents de ces derniers, dictés par des positions et des héritages socio-culturels très éloignés les uns des autres.
La voix des afrikaners : histoire d’un peuple et rejet de l’histoire.
L’histoire de la littérature afrikaner ne saurait être comprise sans une attention particulière portée à l’histoire de la langue ayant forgé cette nation. Construction nationale artificielle issue d’une mutation de la langue originaire, le hollandais, l’afrikaans fut l’écho de toutes les luttes de ce peuple pour l’exercice du pouvoir, de la domination et de la soumission des autres ethnies. Mais avant la période d’apartheid et la victoire du Parti national en 1948, le peuple afrikaner fut également une victime, dans sa confrontation contre l’emprise britannique au cours du 19ème siècle.
Ainsi, un premier type de littérature se distingue au 20ème siècle, né de ces années de lutte anglo-boers, et de la rancoeur persistante des afrikaners à l’encontre des « rooinek » (nom péjoratif désignant les anglais), avec les écrits de Bosman, notamment. Certains auteurs afrikaners, comme le poète Jan Cellier, ont également témoigné de la tristesse ambiante face aux horreurs de la guerre civile passée.
 Un nouveau mouvement se manifeste au cours des années 1930, s’éloignant des thèmes traditionnels de la littérature blanche afrikaner (amour de la patrie, de la nature, de la religion). Ces auteurs, connus sous le nom de « Dertigers », sont à l’origine des toutes premières évocations du Bien et du Mal. Parmi eux, les plus connus restent Van Wyk Louw, Uys Krige, Elizabeth Eybers. Cependant, la question de la traduction de cette langue particulière est toujours restée un problème pour une diffusion plus grande de leurs ouvrages.
Un nouveau mouvement se manifeste au cours des années 1930, s’éloignant des thèmes traditionnels de la littérature blanche afrikaner (amour de la patrie, de la nature, de la religion). Ces auteurs, connus sous le nom de « Dertigers », sont à l’origine des toutes premières évocations du Bien et du Mal. Parmi eux, les plus connus restent Van Wyk Louw, Uys Krige, Elizabeth Eybers. Cependant, la question de la traduction de cette langue particulière est toujours restée un problème pour une diffusion plus grande de leurs ouvrages.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’influence européenne gagna largement les bancs de l’école littéraire afrikaner. Ainsi, les « Sestigers » se sont largement inspirés du nouveau roman français et du surréalisme pour créer une formule littéraire inédite, faite d’une créativité débordante et de thèmes renouvelés (sexe, violence…). Contrairement aux auteurs noirs, muselés par leur besoin de crier leur souffrance et les contours d’une réalité improbable, les auteurs blancs issus de la descendance hollandaise se lancèrent dans une recherche effrenée de nouvelles formes d’oeuvres et de récits. Ce sont d’ailleurs ces auteurs sud-africains afrikaners qui restent les plus connus aujourd’hui à-travers le monde (Etienne Leroux, André Brink, J.M Coetzee ou encore Breyten Breytenbach).
Très vite, ce écrivains forment une classe d’intellectuels, et se démarquent de la masse du peuple afrikaner en grande partie nationaliste. Ils seront les premiers à exprimer clairement les problématiques « éthiques et morales » liées à leur situation, traduisant les questionnements et la culpabilité du peuple dominant. Dans les oeuvres, le langage se complexifie, l’anglais et l’afrikaner se mélangent, se complètent et s’unifient dans une création littéraire très riche et complexe, reflet de son époque.
La voix des anglophones : entre intériorisation d’un système social et combat idéologique.
La littérature anglophone sud-africaine porte toutes les contradictions de ce peuple et de sa position à l’intérieur de la société. Après s’être peu à peu débarrassés d’influences victoriennes pesantes, les écrivains sud-africains anglophones trouvèrent leurs propres marques et parvinrent à mettre à jour une littérature personnelle, purement « sud-africaine ».
Ils se démarquèrent par la suite par leur intérêt sincère pour les littératures noires, et leur combat idéologique contre le régime et la censure ambiante (Olive Schreiner, Nadine Gordimer, ou encore Alan Paton). Un seul auteur vraiment célèbre se détache du fait de son soutien ambigu à la politique de ségrégation : l’écrivain S.G. Millin.
Si l’ironie fut un outil littéraire très largement utilisé pour rendre compte d’une situation sociale « absurdes » (se référer aux écrits de William Plomer ou de Roy Campbell), les auteurs anglophones se démarquèrent principalement par leur grande aptitude à décrire de façon fine et minutieuse le vécu quotidien du pays. Le thème de la « rencontre impossible » entre les peuples en présence est également au cœur de cette littérature.
 Néanmoins, et c’est en cela que le paradoxe apparait complexe et révélateur, la littérature anglophone témoigne également d’une très importante intériorisation du système social en place. Les auteurs, en effet, transportent de façon récurrente l’image servile de l’africain (voir les écrits de Doris Lessing notamment), et les angoisses du Blanc face au Noir (Jean Sévry parle de « fantasme de dévoration » pour évoquer la crainte persistante du Blanc de se voir dévorer par le Noir à tendance cannibale ; il évoque aussi la peur du Blanc de perdre la pureté de sa race). L’influence de la culture de la servitude du Noir dans les familles anglophones va tellement loin que Laurens Van der Post se demande, dès le début des années 1960, si le Blanc ne serait pas tout simplement frappé de cécité… (The dark eye in Afrika, 1961).
Néanmoins, et c’est en cela que le paradoxe apparait complexe et révélateur, la littérature anglophone témoigne également d’une très importante intériorisation du système social en place. Les auteurs, en effet, transportent de façon récurrente l’image servile de l’africain (voir les écrits de Doris Lessing notamment), et les angoisses du Blanc face au Noir (Jean Sévry parle de « fantasme de dévoration » pour évoquer la crainte persistante du Blanc de se voir dévorer par le Noir à tendance cannibale ; il évoque aussi la peur du Blanc de perdre la pureté de sa race). L’influence de la culture de la servitude du Noir dans les familles anglophones va tellement loin que Laurens Van der Post se demande, dès le début des années 1960, si le Blanc ne serait pas tout simplement frappé de cécité… (The dark eye in Afrika, 1961).
On retiendra principalement, au sein de la littérature anglophone sud-africaine, une tendance très claire à la complexité littéraire, à des recherches esthétiques extrêmes et nombreuses faisant appel à des images et à des imaginaires inhabituels. On ne peut s’empêcher d’interpréter cette frange de la littérature anglophone comme une volonté de fuir au plus loin du réel, mais on notera cependant un effort certain chez ces auteurs (J.M. Coetee, Breyten Breytenbach, André Brink…) pour rester fidèle au contexte nourrissant leur écriture. Nous accorderons également à la littérature anglophone une valeur politique, malgré tous les paradoxes que nous venons d’évoquer, comme reconnaissance de la volonté générale de ses auteurs de mener une démarche visant autant que possible à « réveiller les consciences endormies. » (Jean Sévry)
-
Les voix métisses : la défense de l’homme de couleur en première ligne.
La littérature métisse, nous dit Jean Sévry, se confond quasiment totalement avec la littérature noire, du fait de son engagement total en faveur de « la défense de l’homme de couleur ». Ses auteurs, dont Peter Abrahams et Alex La Guma sont les plus célèbres, nous parlent de la prison, nous raconte le drame du banissement et les traumatismes de l’exil.
-
Les voix indiennes : la remise en cause d’une ethnie confortablement installée dans le compromis.
A-travers la voix d’Ahmed Essop, la littérature indienne s’est questionnée quant à la position intermédiaire de sa Communauté dans le pays. Jean Sévry, pour résumer les thèmes évoqués par ces auteurs, évoque « la corruption de la bourgeoisie indienne » et de « la petite bourgeoisie de fonctionnaires et d’enseignants souhaitant jouer aux petits chefs« … Situation ambigüe et questionnement d’une culture « moyenne » se contentant d’être « moyenne » dans une Afrique du Sud trop peu malléable pour être affrontée.
2) Les différents thèmes traversant la littérature sud-africaine : une parole de l’humain au-delà des origines ethniques.
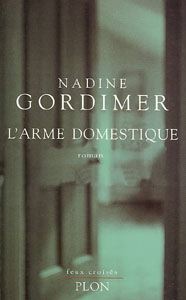 Après avoir « catégorisé » les voix de la littérature sud-africaine, il est intéressant de constater que cette distinction nette s’atténue lorsque l’on entre dans les oeuvres elles-mêmes, et que l’on observe le choix des thèmes expérimentés par ces auteurs sud-africains. Au final, nous nous rendons compte que les repères de ces individus partageant la même société, et qui leur permettent de transmettre constats et ressentis, se rapprochent davantage de leur condition d’êtres humains que de leur affiliation à un groupes ethniques particuliers. Ainsi, ce sont davantage les façons d’aborder les sujets (conditions d’énonciation et styles employés) qui marquent les différences. Au cœur de tous ces thèmes : la « rencontre », souvent impossible, parfois destructrice…
Après avoir « catégorisé » les voix de la littérature sud-africaine, il est intéressant de constater que cette distinction nette s’atténue lorsque l’on entre dans les oeuvres elles-mêmes, et que l’on observe le choix des thèmes expérimentés par ces auteurs sud-africains. Au final, nous nous rendons compte que les repères de ces individus partageant la même société, et qui leur permettent de transmettre constats et ressentis, se rapprochent davantage de leur condition d’êtres humains que de leur affiliation à un groupes ethniques particuliers. Ainsi, ce sont davantage les façons d’aborder les sujets (conditions d’énonciation et styles employés) qui marquent les différences. Au cœur de tous ces thèmes : la « rencontre », souvent impossible, parfois destructrice…
Ainsi, et je continue ici à approuver les observations de Jean Sévry, l’enfance est un thème récurrent dans les oeuvres sud-africaines du 20ème siècle. Témoignages d’amitiés spontanées entre enfants de couleurs différentes sous la plume d’écrivains anglophones (se référer aux écrits de Doris Lessing, qui aborde à de nombreuses reprises les rapports ambigus des sud-africains anglophones avec leurs serviteurs noirs) ; visions violentes de la haine d’enfants noirs des townships contre les Blancs souvent assimilés aux forces de police répressives ; l’enfance offre la possibilité d’un point de vue unique sur un temps passé où la rencontre était encore possible, même fictive et théâtralisée (William Modisane raconte comment les enfants noirs aimaient imaginer des mises en scènes où le Blanc tenait toujours le rôle du méchant). Point commun de cet appel à l’enfance chez les auteurs sud-africains : la référence à une époque où tout était possible, et dont la liberté s’effrite à mesure que la vie d’adulte s’installe.
L’univers carcéral, imagé (l’écrivain Jan Rabie décrit le monde dans lequel il vit comme une maison sans porte ni fenêtre, aux blocages permanents et sans issue) ou réel (la geôle, la prison, la salle de torture…) traverse également la littérature sud-africaine en période d’apartheid, quelque soit l’origine sociale de l’auteur y faisant référence (ainsi, aussi bien Zwelonke, auteur africain noir, que Breytenbach, auteur blanc anglophone, témoigne de leur expérience carcérale).
 Enfin, et c’est peut-être le thème abordé le plus largement et le plus logiquement partagé par l’ensemble des écrivains en présence, l’interdit est une routine de la littérature sud-africaine. Cet interdit, c’est l’Autre, celui avec lequel nous ne pouvons communiquer, celui auquel nous ne sommes reliés que par des chainons législatifs oppressants et tendancieux. Témoigner de cet interdit représentera un challenge et une obligation pour nombre d’écrivains perdus dans les dédales de leur propre condition, en proie à de terribles élans de solidarité et à d’irrépressibles envies de « comprendre ».
Enfin, et c’est peut-être le thème abordé le plus largement et le plus logiquement partagé par l’ensemble des écrivains en présence, l’interdit est une routine de la littérature sud-africaine. Cet interdit, c’est l’Autre, celui avec lequel nous ne pouvons communiquer, celui auquel nous ne sommes reliés que par des chainons législatifs oppressants et tendancieux. Témoigner de cet interdit représentera un challenge et une obligation pour nombre d’écrivains perdus dans les dédales de leur propre condition, en proie à de terribles élans de solidarité et à d’irrépressibles envies de « comprendre ».
Jean Sévry distingue trois tendances exploitées par les écrivains sud-africains pour rendre compte de cette transgression :
La première consiste à « se mettre » dans la peau de l’Autre. Elle est souvent le choix des auteurs blancs ou métis, mais rarement des auteurs noirs… Car il s’agit d’une écriture de la culpabilité et du repentir, de l’introspection et de la recherche de sa propre responsabilité face aux évènements qui nous dépassent. Peter Abrahams, écrivain métis, tente ainsi de se mettre dans la peau d’un Blanc pendant la conquète (Wild conquest, 1950) ; André Brink se glisse dans la peau d’un Métis condamné à mort (Looking on Darkness, 1974) et découvre ainsi les souffrances de tout un peuple ; J.M. Coetzee, autre écrivain blanc, écrit l’histoire d’un juge s’identifiant si fort à sa victime (une jeune indigène) qu’il finit par prendre sa place dans sa cellule (Waiting the Barbarians, 1981)… « Car ce jeu de miroirs que l’on tend à l’autre pour saisir son reflet finit par se retourner contre celui qui le brandit. Et l’écrivain blanc se retrouve solitaire, face à un miroir brisé, à une image fracturée qui le crible de ses reproches. » (Jean Sévry)
La seconde option s’offrant à l’écrivain désireux d’expérimenter l’interdit consiste, dans une démarche plus perverse, à « prendre la place » de l’Autre, et à inverser les rôles des différents protagonistes. Cette formule littéraire permet un épanouissement du sud-africain noir refoulé (prenons par exemple la nouvelle de Lewis Nkosi qui décrit une situation dans laquelle le maitre blanc succombe aux charmes de sa servante noire et se retrouve pris au piège de sa propre situation), et l’expression de la crainte du Blanc face à sa possible destitution (la littérature blanche sud-africaine regroupe un grand nombre de nouvelles et de romans qui traitent d’un même thème : « un blanc qui perd sa blancheur, qui sombre dans le monde de l’autre et ne peut plus s’arracher à sa bâtardise, perçue comme une dégénérescence« ). On devine ici l’importance de la sexualité comme vecteur de transgression, mais aussi de contact (« La sexualité permettrait ainsi de mettre à nu le désir de l’Autre, exacerbé par les interdits de l’apartheid et par la même occasion, la répression exercée par le puritanisme ambiant. »)
Au final, conclut Jean Sévry, « Tous ces choix sont politiques. Tous tentent d’accéder à une communication interdite« . Et il complète encore : « Il est intéressant de remarquer en passant qu’une société qui censure toute communication entre les groupes sociaux en présence a donné naissance à une littérature véritablement obsédée par ce thème de la rencontre, qui est alors vécue dans l’imaginaire comme un rêve impossible. C’était déjà le cas de la littérature russe du temps de Tolstoï« .
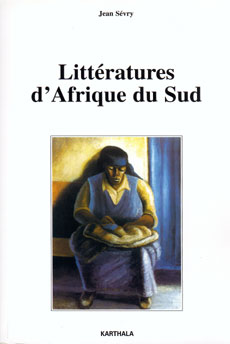 La littérature, en tant que vecteur des émotions et des vécus de tout un peuple, s’impose donc bien comme l’espace du témoignage et de la revendication, et comme le lieu de la fuite possible et désirée des réalités insoutenables. Ainsi, entre imaginaire et réalisme, la littérature sud-africaine du 20ème siècle aura su accompagner son peuple dans le sens d’une marche en avant, en offrant rémission, catharsis, et espoir d’unification pour l’avenir.
La littérature, en tant que vecteur des émotions et des vécus de tout un peuple, s’impose donc bien comme l’espace du témoignage et de la revendication, et comme le lieu de la fuite possible et désirée des réalités insoutenables. Ainsi, entre imaginaire et réalisme, la littérature sud-africaine du 20ème siècle aura su accompagner son peuple dans le sens d’une marche en avant, en offrant rémission, catharsis, et espoir d’unification pour l’avenir.